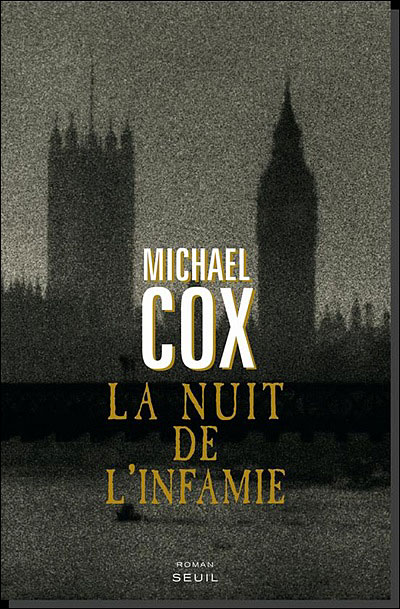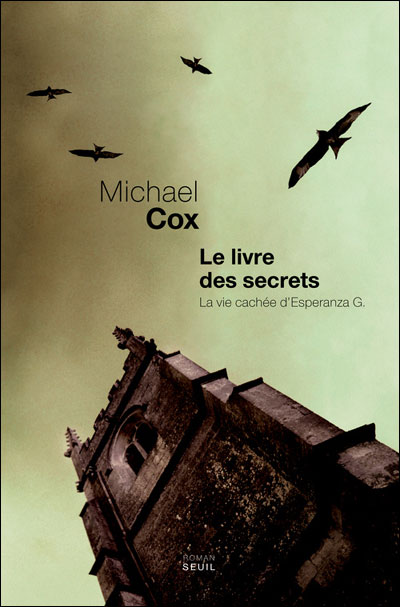Re: (HS) La Bibliothèque Verte
Publié : 31 juil. 2009, 15:07
par rising 42
Jacques Chauviré.
Tout est bon chez lui... Il n'y a rien a jeter... Sur l'île déserte, il faut tout emporter...
J’ai tout à fait l’impression de ne pas avoir fait le tour de mon domaine et d’avoir laissé dans l’ombre certains pans, vécus ou imaginés. Mon métier et ma position d’observateur et de confident ne me permettaient pas toutes les libertés. L’un de mes rêves serait d’écrire encore une vaste fresque dont les personnages multiples seraient tous ceux que, jeune médecin ou vieux docteur, j’ai découverts ou rencontrés à Neuville-sur-Saône, qu’on appelait autre fois Neuville-l’Archevêque, et dans les villages voisins : artisans, commerçants, paysans, ouvriers, instituteurs, notaires et rares cadres d’entreprise. Je les ai aimés. En ma mémoire je vis avec eux. Je voudrais témoigner de ce qu’ils furent, évoquer leurs personnalités si diverses, les suivre au cours de leurs vies et les ressusciter dans leur intimité, raconter leurs unions de village en village, rappeler les parentèles qui, de bourg en bourg, tissaient la toile de mes visites de médecin familier. Autre pan écarté : l’amour qui tant donné est absent de mon œuvre. Tout cela exige le secret ou, du moins, la pudeur.
Jacques Chauviré, Entretien avec Gilles Ortlieb. Revue Balmoral N°41, Printemps-Eté 2002.
Jacques Chauviré est né en 1915 à Genay dans l’Ain. Il ne connaîtra jamais son père, tué à la guerre. On ne peut s’empêcher de penser ici à Camus, et d’expliquer ainsi, au moins partiellement, la sensibilité et l’intelligence commune qui s’exprimera plus tard dans une longue correspondance. Après des études de médecine à la faculté de Lyon, en compagnie de Jean Reverzy, l’auteur du Passage, qui deviendra son ami, il fut pendant quarante années médecin généraliste à Neuville-sur-Saône.
À la fin des années cinquante, Chauviré écrit à Albert Camus, engage une correspondance, dont on retrouve parfois les échos romancés dans ses livres. C’est Albert Camus qui retiendra son premier manuscrit et le présente à Gaston Gallimard. De 1958 à 1980, il publiera six romans chez cet éditeur.
L’un des tous premiers, Les Passants, réédité en 2001 par le Dilettante, n’est pas sans rappeler celui de Reverzy, Le Passage. Les Passants, ou comment, d’une chose à l’autre, se trouver transporté en terrain connu, voire de connivence. À Jullianges, petite ville de banlieue ouvrière, un jeune médecin, le Docteur Desportes, voit défiler tout un concentré d'humanité dans le cabinet qu'il vient d'ouvrir. Il soigne les corps, mais ne peut pas apaiser les âmes. Il s’agit-là d’une véritable épopée de l'insignifiance.
Je suis arrivé à Jullianges depuis une semaine. Toutes les petites villes d’une banlieue ouvrière se ressemblent, et celle-ci ne diffère certainement en rien des cités qui, de Bléricourt à Terrenoire, en passant par Replonges, accompagnent le cours de la Brévince. Pour être très certainement inventés, ces noms n’en délimitaient pas moins une sorte de paysage irréfutable et aussitôt familier — de ceux dont les maisons se touchent et dont la rue principale, bordée d’usines, n’est que la route qui les unit entre elles.
Je me suis décidé à abandonner mes fonctions de médecin d’usine pour ouvrir un cabinet. Je pense que ma santé affermie me permettra de faire face à mes obligations, bien qu’il soit possible que la vie qui m’attend ne soit pas d’une extrême facilité. Ces difficultés forment précisément la trame et le fond du roman, où l’on voit le Docteur Desportes, confrère provincial du Docteur Louis-Ferdinand Destouches (Céline), tâcher de se constituer une clientèle entre rivaux et alliés, déjeuner parfois seul, le dimanche, à l’hôtel du Commerce, place Jules Ferry, retrouver d’autres fois l’instituteur Rivoire, que guette un étrange mal intime, et prodiguer soins, conseils, encouragements sans jamais, ou presque, se départir d’une attitude à la fois distanciée, lucide et attentive. Les médecins écrivains formeraient-ils une famille ou une école à part, comme on parle d’auteurs prolétariens ou d’écrivains voyageurs ? (Gilles Ortlieb). Quelques fois, à la lecture de Jean Reverzy, de Miguel Torga ou, plus près de nous, de Martin Winckler, on ne serait pas loin de le croire. Comme si à l’art du portrait qui relève du travail de tout romancier, venait dans leur cas se superposer une connaissance quasiment clinique de ce qui fait agir les personnages et risque d’en condamner certains, en conférant par là-même à l’auteur un statut d’observateur privilégié, et fatalement peu optimiste. À ceci près que, de constats en aveux, la vie personnelle du narrateur apparaît, dans Les Passants, à peine moins désemparée que celle de ses patients. Le refus délibéré d’en laisser ou de s’en faire accroire est l’un des mérites de cette entreprise romanesque, dont le nuancier ne semble compter que des demi-teintes, et aucune couleur trop vive. (Gilles Ortlieb).
Depuis mon séjour à Replonges, j’ai appris à aimer cette grisaille de la banlieue. Je m’y sens à l’aise. Lorsqu’on s’y est incorporé on y découvre une chaleur, une fidélité tacite et résignée qui me conviennent.
Entre le petit Louis Colin, le gendarme Labrousse, les familles Mouillard et Frachini, Mademoiselle Duvillard et sa mère, le couple Truchaud et tous les personnages, aux patronymes aussi convaincants que les lieux-dits, dont se compose une petite société de province, un constat identique de fidélité s’applique aux êtres : Il est vrai que mes livres n’ont pas de héros et que leurs personnages sont gens du quotidien. Ce sont eux que j’ai rencontrés. Ils m’ont paru dignes d’intérêt parce que simples, pudiques et souvent fidèles. Sans dévoiler ce qu’il advient aux uns et aux autres, où il incombe parfois au médecin de les accompagner, il est évident que l’expérience humaine ainsi recueillie à leur chevet vaut bien celle de nombreux globe-trotter.
Le début des Passants contient incidemment un très court résumé du premier roman, celui-là même que Camus avait fait publier chez Gallimard en 1958, Partage de la soif : Pendant six ans j’ai occupé à Replonges un poste de médecin du travail dans une usine de textiles et cette expérience a été , en définitive, un échec. Si géographiquement le décor est le même, le mobilier des journées et leur emploi du temps tiennent ici presque tout entiers dans le local de l’infirmerie. Jacques Chauviré y surveille cette vie qu’on a planté en nous comme une perfusion, qui inonde d’une tristesse sans fin, étoilées de plaisirs fugaces. Partir le matin, revenir le soir : question d’habitude. Quant à la place de médecin d’usine, elle ne tarde pas à se révéler aussi peu confortable que celle d’un praticien en quête de clientèle. Car il apparaîtra assez vite que, à la charnière entre la patron, le délégué syndical, et la masse indifférenciée du reste du personnel, la position n’est pas tenable à terme par quiconque refuse de choisir son camp, à plus forte raison lorsqu’une grève éclate dans les ateliers, qui limite irréductiblement à deux le nombre des camps possibles. Sur le versant de la vie privée, les choses, là non plus, ne se présentent pas au mieux, avec un lien conjugal usé qui conjugué aux difficultés professionnelles souligne le manque d’une raison d’être.
À l’horizon de la plaine, il y a une ligne de chemin de fer qui court parallèlement à la route. Chaque jour, je suis dépassé par le train qui passe à huit heures à Blèche en provenance de Barleux. À cette heure les wagons sont encore éclairés, comme le projecteur d’une gare de triage. La pauvreté des noms de villages, le bruit heurté et sourd des lourdes rames qui s’entrechoquent dans ces gares isolées ne font jamais surgir en moi le moindre désir de voyage et, dans l’aube de l’hiver, le haut pylône qui supporte le phare évoque à mes yeux le mirador de nos captivités. La mer, le ciel et la plaine m’ont toujours enseigné la prison.
Pour suivre un ordre chronologique, le roman suivant, longtemps introuvable et réédité en 2008 par les Editons Le Temps qu’il fait à Cognac, est sûrement le plus ambitieux dans l’œuvre de Jacques Chauviré. Paru en 1964, Le Temps et la Guerre, (les majuscules ont été imposées ici par l’auteur, pour donner l’impression de se retrouver, comme devants certains substantifs allemands, confrontés à des entités telles que le Monde, la Loi, le Sol ou la Mort) ne dépaysera pas le lecteur des deux romans précédents — Lyon et la Saône ne sont pas loin — , sinon par l’époque dans laquelle l’action se situe. Le livre débute le 23 août 1914, soit quelques semaines après l’ordre de mobilisation, dans une région, la Combes, un domaine, la Bervillière, et une famille de vieille souche, les Calvière.
Tout au long de ce vaste ouvrage, bien que le lecteur n’en soit jamais le témoin direct, c’est pourtant bien le front qui disputera la première place aux personnages divers. Même si au bout du compte, la guerre n’est jamais que ce que l’on en rapporte : quelques pages d’un journal tenu sur place, une méchante blessure, une citation, un séquestre, un morceau d’obus fiché dans un poumon ou encore rien de plus qu’une montre, une poignée de lettres et une plaque d’identité en aluminium. Il s’agit ici de la guerre vécue de l’arrière, par les enfants, les femmes, les paysans et ceux qui en sont revenus, dans tous les sens du terme.
Jérôme et Lucie Calvière errent dans les rues brûlantes d’un village en bord de Saône. Leur fils et leur gendre, mobilisés, laissent un vide immense derrière eux, et la lutte pour ne pas le laisser s’installer tout en restant sans nouvelles, ni pouvoir se représenter les périls auxquels étaient exposés les soldats les engagent dans un voyage aux limites de leurs forces. Les lettres des paysans arrivent, avec les premiers disparus et le pressentiments des mutineries de 1917. Dans le recueillement anxieux amorti par la douceur d’une grande propriété près de Lyon, la famille se resserre, se tend, se distend, les filles se révoltent, rentrent dans le rang, la religion n’est jamais loin des mouvements de remise au pas, si ce n’est par le biais d’un curé, c’est par la peur.
Le temps s’égrène pourtant lentement à l’arrière, au rythme de l’attente d’apprendre quel village donnerait au canton son premier mort. Dans le pas des saisons, des moissons, des vêlages, des ciels changeants, s’inscrivent les transmutations des rapports à l’argent, des générations entre elles, des aspirations aux ascensions sociales, des premiers déséquilibres économiques, qui déstabilisent en profondeur ces bourgeois et leurs valeurs. En contrepoids du danger qui menace les jeunes corps perdus sur le front, tout autant que la désagrégation du monde de Jérôme, la terre faisait naître en lui un désir toujours plus profond et plus insatiable de peser sur ce sol de tous le poids de son corps.
Mais, au-delà de l’évocation, à la manière de Joseph Roth, d’un monde agonisant, le roman sait aussi être rétrospectivement visionnaire, lorsqu’il dévoile la formidable force d’entraînement de la guerre, qui permet à certains trafiquants ou fabricants d’amasser en quelques mois des fortunes qu’il fallait vingt années pour bâtir. Pendant que les jeunes filles de bonne famille s’essaient à la peinture non figurative, des domestiques attachés depuis toujours à la famille voient leurs enfants s’en aller travailler en usine, s’inscrire à des cours du soir et s’élever ainsi de quelques barreaux sur l’échelle sociale. Font également irruption par le biais des conversations des choses vues à la ville des bribes puis des pans entiers du monde appelé à remplacer l’ancien lorsque les hostilités auront cessé. Car c’est l’époque où, aux côtés d’un Modigliani encore inconnu, tel poète bourlingueur et récemment amputé commence à se faire connaître par des proses ferroviaires sans antécédents… (Gilles Ortlieb).
Dans sa sécheresse, son laconisme, l’épilogue de La Terre et la Guerre témoigne qu’il est des glissements de terrain irréversibles, mais que sur le sol maintenant aplani rien ne va cesser d’être, ou tout va recommencer : Le vieil homme mourut un soir de septembre 1922. Son aîné l’accompagna deux ans plus tard. Laurence Leblond et Jean Calvière vendirent leurs parts de la Bervillière et Amélie ne put les acheter. Elle vint habiter seule la maison sur la place.
Publié après cette imposante fresque en 1971, La Confession d’hiver n’est pas une épopée, mais une sorte de suite au roman précédent sous forme de monologue, énoncé d’une traite, sur un ton confidentiel, en l’espace de deux soirées, devant un auditeur qui recueille les propos sans jamais les commenter. Le sujet est à nouveau le quotidien d’un médecin dans une petite localité, Malaterre, à égale distance entre un canal navigable, détail d’importance, et une usine de produits chimiques. Sans appartenir à ce prolétariat de médecins qui ahane aux montées d’étages, gèle en hiver et transpire en été pour gagner sa chienne de vie, le narrateur ne se range pas davantage dans le corps des praticiens hautement titrés, qui est en quelque sorte la fleur et la clef de voûte de la corporation. Sa confession apparaît comme le récit des pièges que la mesquinerie et les circonstances peuvent tendre à un médecin de quartier partagé entre le goût et la lassitude de son métier, entre la nécessité de soulager autrui, et celle, parfois, de lui dissimuler la vérité, assailli comme chacun par les grands et les petits soucis qui tournoient au-dessus de lui comme les mouettes à l’aplomb d’une écluse.
Six années s’écoulèrent jusqu’à la parution, en 1977, de l’avant-dernier roman de Jacques Chauviré, Passage des émigrants, réédité par le Dilettante, qui est reconnu comme son ouvrage le plus fort et le plus abouti. Le personnage désormais familier du Docteur Desportes y officie, l’auteur l’affectant cette fois-ci au soin des pensionnaires d’une résidence pour personnes âgées. Ce livre est l’histoire, à la fois terriblement commune et infiniment profonde de quelques-uns de ses émigrants, qui, au crépuscule de leur vie, commencent leur douloureux voyage vers la mort. Ils se retrouvent dans une résidence, dont Jacques Chauviré, à travers un couple de vieillards comme les autres, les Montagard, raconte le fonctionnement et l’atmosphère. Le Docteur Desportes est l’observateur patient et mélancolique du destin de ces êtres en fin de parcours dont il a la charge. Quant à moi, affirme-t-il, la vieillesse me passionne. Grâce à son étude, on parvient à l’approche d’une vérité, de la vérité.
Le style paisible et sans affectation de l’auteur recèle une rythme et un balancement significatifs. Comme dans les précédents romans, Chauviré masque la dimension anodine des évènements qu’il raconte — la vie banale de personnages ordinaires, d’un hospice parmi tant d’autres, d’une région rurale française clairement identifiée — une conscience du tragique de l’existence terrestre et de l’insaisissable sens de la vie humaine., s’il y en a un. Le monde existe, nous y sommes et c’est tout, lâche Desportes à al fin du livre.
Chez Jacques Chauviré, l’écrivain et le médecin se mêlent, littérature et médecine amenant à scruter et à comprendre la même mélancolie. On retrouve dans ce livre plusieurs thèmes récurrents dans l’œuvre de l’auteur, thèmes qui font de ses livres gris, comme lui-même les qualifie, l’individualisme et le délitement des liens sociaux. La vieillesse n’intéresse au fond personne. Les vieux sont devenus les asociaux de notre temps car chacun les juge encombrants bien qu’inoffensifs. Ce livre élégant, dont le véritable sujet aura finalement toujours été la conscience de la mort. Conscience inhérente à toute vie, et que la vieillesse rend simplement plus intense, jusqu’au désespoir. Tout corps prépare sa propre déchéance. La mort n’est qu’un suicide méconnu.
Avec le Passage des émigrants, on touche à la littérature de confinement, dont Le Dernier Chapitre d’Hamsun, La Salle N°6 de Tchékhov (autre écrivain médecin) ou encore La Montagne magique de Thomas Mann constituent de mémorables précédents.
S’il est de bonnes raisons de penser que tous les livres de Jacques Chauviré sont, à des degrés divers, autobiographiques, Les Mouettes sur la Saône apparaît comme celui dont le fil remonte le plus loin dans l’enfance. Il est même troublant de constater à quel point ce roman semble précisément reprendre les choses là où La Terre et la Guerre les avait laissées : même époque, années 20, mêmes paysages où étangs, rivières et eaux de ruissellement abondent, mêmes ritournelles d’après-guerre, sans parler des nombreuses similitudes entre les demeures familiales, comme entre les personnages qui les fréquentes. L’angle de vue apparaît toutefois différent, puisque l’auteur est un adulte qui, se retournant vers l’enfant qu’il a été, le redevient le temps du récit et regrandit avec lui, en compagnie désarmante d’un cousin dont les surnoms se dégraderont au fil des ans — à mesure que son retard au monde deviendra plus flagrant : Frédéric, Fred, Freddy, Billy, Bill,Baby, le Bouib, le Babouin… Toute la force du récit tient à la véracité des dialogues, scènes et rituels rapportés, par lesquels un enfant va comprendre qu’on ne vit pas impunément.
Mais les fenêtres s’ouvrent sur la rivière. Je ne me suis jamais beaucoup éloigné d’elle. En cette après-midi de janvier, sous le soleil d’hiver, elle demeure immuable dans son incroyable lenteur. Large et silencieuse, elle coule et ne coule pas. Le ciel s’est entrouvert. Des mouettes dérivent lentement dans la lumière. Des mouettes dérivent lentement dans la lumière. Les eaux froides scintillent. C’est sur ces phrases que s’ouvre ce dernier roman, avec l’eau omniprésente, telle un marque de fabrique pour l’œuvre entière de Chauviré.
Il faudra attendre la publication de Fin de journées, en 1990, pour disposer, en annexe à deux nouvelles brèves et cinglantes : L’Absence et La Possession, de quelques clés autobiographiques et de quelques lumières sur les circonstances dans lesquelles cette œuvre avait été composée.
Après avoir rangé ses ordonnances et près de treize d’inactivité littéraire, Jacques Chauviré reprend la plume. À quatre-vingt huit ans, après ce long silence, l’auteur découvre le sentiment amoureux avec le scintillant Elisa, petit ouvrage publié aux Editions le Temps qu’il fait qui lui permet de goûter enfin aux plaisirs d’une reconnaissance tardive.
Porté par l’écriture cristalline d’un enfant, ce mince récit lumineux et malicieux a les propriétés curatives d’une eau de jouvence. Il s’agit de l’histoire d’un premier amour, vécu par un petit garçon dans la fraîcheur de son innocence, alors que l’ombre de la Grande Guerre ne cesse de raviver les feux de la détresse du père inconnu, tombé au champ d’honneur, d’une mère inconsolable et exclusive.
Des jours passèrent et la complicité qui m’unissait à Elisa s’affirma.
Dans les après-midi d’automne où la pluie ne me permettait pas de jouer dans le jardin je demeurais auprès d’elle dans la cuisine? Inoccupé, j’y tournais en rond au grand dam de Marguerite. Comme avant, comme toujours, Marguerite cousait ou reprisait, assise devant la fenêtre. Et maintenant Elisa se trouvait en face d’elle, occupée à des travaux similaires dont, comme moi, elle ne voyait pas l’utilité. Elle abritait sans doute en elle une parcelle d’enfance et je pensais qu’elle aurait aimé être ailleurs pourvu que ce fût avec moi.
Au fil des heures je m’efforçais de m’approcher d’elle de plus en plus près. Elle m’attirait, j’aimais ce qu’elle était.
Il m’arrivait enfin de m’appuyer à elle, contre son bras qui tenait l’aiguille ; elle me parut un peu gênée. Toutefois elle me le permit.
— Viens, me dit-elle comme pour se libérer, je vais te préparer ton goûter.
— Bientôt tu me feras des gaufres.
— Attends un peu que je sois au courant des habitudes de la maison. Mais je te promets de demander l’autorisation.
Des gaufres ! C’était à mon sens une avancée dans l’intimité.
C’était le matin, à notre lever, que maman me témoignait le plus d’affection, m’entourait de ses souvenirs, de ses recommandations et de ses plaintes.
Elle m’entretenait surtout de mon père disparu. Il était mort à trente-trois ans pour la patrie. Je me demandais si l’on était vieux ou jeune à cet âge. Et la patrie, qu’était-ce ? Le jardin, les près, les fermes d’alentour ?
— Tu es ma consolation, me disait maman. C’est fou ce que tu ressembles à ton père. Ah ! S’il t’avait connu il n’aurait pas pu te renier. Tu as la même façon de marcher et je pressens que tu auras la même voix et le même nez, un peu fort. Il était vraiment gai ton père. Il avait l’habitude depuis notre mariage de siffloter en marchant. Toujours décidé et d’un bon pas. Regarde sa photo sur la tablette de la cheminée.
Chaque matin ou presque, respectueux et admiratif, je jetais un œil sur la photo de ce sous-lieutenant casqué au beau profil dressé sur la terre de Champagne dans sa longue capote boutonnée.
Je n’étais pas très ému. Je me soumettais plutôt à ce mouvement rapide du regard qu’on m’invitait à accomplir comme appartenant à la prière matinale.
La fluidité de l’écriture, conjuguée à l’ardeur des sentiments, confinent au miracle lorsque la belle Elisa resurgira en fin de volume, et consentira, quelques marguerites sur les mains, à passer aux aveux.
Jacques Chauviré disparaît en 2005 à l’âge de 90 ans. Il n’aura pas eu le temps de voir paraître Massacre en septembre, toujours aux Editons le Temps qu’il fait, un recueil en kaléidoscope d’un enfant vieillard des bords de Saône. Quelques nouvelles rassemblant son dernier souffle, ses derniers coups de griffes, coups de gueules aussi, bien dans son style, en apparence assourdis par un ton policé, un petit rien de désuet, mais sans concession contre la bêtise, la lâcheté, les aménagements ordinaires des uns et des autres avec la cruauté ou l’indifférence. On y trouve ce rire clair et simple d’un enfant insolent, et aussi l’époque où la France était une nation de paysans, où les instituteurs enseignaient aux enfants l’histoire de leur pays et de leur province, et celle aussi des années d’après-guerre, des paysages rustiques et sereins : Le village, entre Dombes et Saône, n’abritait pas plus que trois cents âmes. Des ruisseaux couraient sur ses pentes. Des troupeaux paissaient de grasses prairies. Les toits des fermes étaient de tuiles romaines.
Pour conclure, laissons l’écrivain s’exprimer :
En 1942, je me suis installé à Neuville-sur-Saône comme médecin généraliste. J’y suis resté quarante ans. Les fenêtres de mon bureau donnaient sur la rivière. Depuis lors, je ne suis guère retourné à la ville. Après avoir exercé pendant quelques années et après avoir beaucoup lu, il m’a paru nécessaire et naturel de m’interroger sur le sens de mon métier. J’avais, au fil des temps, appris que le médecin perd toujours. […] De temps en temps, je partageais la joie de guérisons. Mais celles-ci ne compensaient pas le scandale de la souffrance et de la mort. Et je pensais que mon métier illustrait bien le mythe de Sisyphe et qu, au fond, il n’était pas sans grandeur. Un soir d’été, j’écrivis à Camus qui me répondit. De la naquit une correspondance. Au lendemain d’un jour où la rivière et ses eaux que j’aimais m’avaient trahi par la noyade d’un enfant de l’un de nos amis, j’adressai à Camus un texte bref que j’avais intitulé Recherche et perte du fleuve. Camus me conseilla de continuer à écrire.
"Nuits blanches" QLL Août 2009. ©[/b]
Re: (HS) La Bibliothèque Verte
Publié : 01 août 2009, 17:26
par Edward G.
Deuxième volet de ma série "la littérature anglaise".
Aujourd'hui je vous présente 4 romans paru chez Belfond et mettant en scène Matthew Shardlake, où les pérégrinations d'un avocat bossu dans une Angleterre du 16è siècle en proie à des luttes politico-religieuse intestines !
Les amateurs du frère Cadfael, héros des romans d'Ellis Peters ne devraient pas être déçus. Nombre de critiques s'accordent même à dire que l'élève CJ Sansom aurait dépassé le maître (ou plutôt la maîtresse). Personnellement, je suis dans l'incapacité de me prononcer, n'ayant jamais lu un seul "Cadfael".
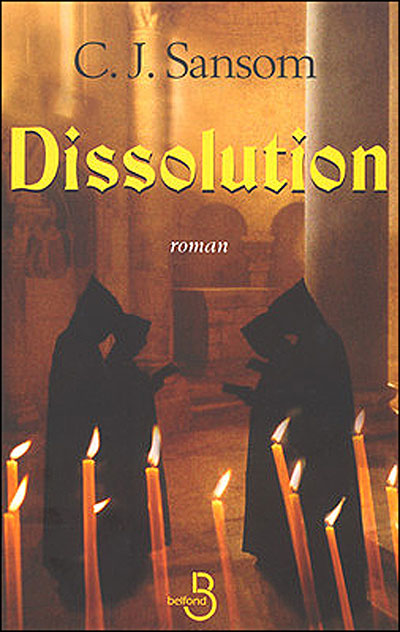 Quatrième de couverture :
Quatrième de couverture :
Angleterre, 1537. En butte aux menées du redoutable Thomas Cromwell, le clergé catholique jadis tout-puissant perd son pouvoir, voit ses biens confisqués et ses monastères menacés de dissolution.
Partout, la révolte gronde. Après la décapitation d'un commissaire du roi à Scarnsea, l'ardent réformateur anglican Matthew Shardlake est envoyé sur les lieux.
Dans le monastère glacial, son enquête se heurte au mutisme des moines. Chacun d'entre eux semble avoir quelque chose à cacher. Quels secrets pèsent sur ces lieux ? Qui veut-on protéger ?
Alors que la mort frappe de nouveau, Shardlake doit percer au plus vite les mystères de cette étrange congrégation. Mais il ignore encore à quel point de terribles découvertes ébranleront ses plus profondes convictions...
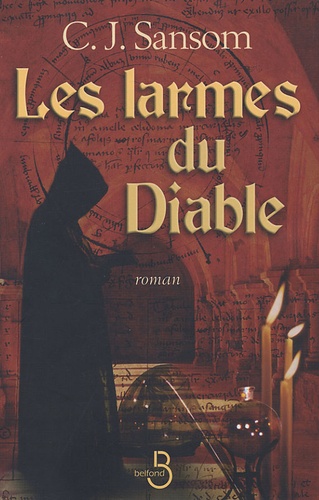 Quatrième de couverture :
Quatrième de couverture :
Londres, été 1540. Une jeune femme, Elizabeth Wentworth, encourt la mort pour l’assassinat supposé de son cousin. Serait-elle habitée par le malin ? La plupart le croient… Mais ni son oncle, ni le toujours perspicace Matthew Shardlake, avocat bossu qui déjà menait l’enquête dans La Dissolution (2003). Chargé par Cromwell de mettre de l’ordre dans cette histoire trouble, aux relents de soufre, qui risque de coûter la vie à une innocente, l’avocat va très vite se mettre sur les traces de la formule permettant de composer les larmes du diable, entendez-le feu grégeois, arme redoutable inventée par les byzantins : si, en moins de douze jours, l’avocat est capable de rapporter le secret de ce feu guerrier à Cromwell, la jeune Elizabeth Wentworth évitera le supplice… Alors autant se presser !
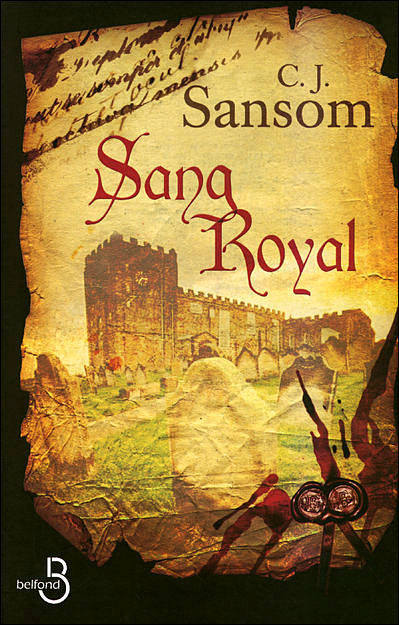 Quatrième de couverture :
Quatrième de couverture :
York, 1541. Aux portes de la ville, quatre têtes coupées sur des piques, font le régal des corbeaux. C'est la réponse, royale et sanglante, à la conspiration papiste. Bientôt, le roi lui-même viendra mettre un terme, par sa seule présence, aux troubles de la province.
D'ici là, Matthew Shardlake, avocat à la Cour, assurera la protection du meneur catholique, le bouillant Broderick, jusqu'à son transfert à Londres où l'hérétique sera remis aux questionneurs de la Tour… Quel entêtement dans son silence ! Très vite, Shardlake devine que la rébellion du Yorkshire menace bien moins l'unité religieuse du pays que la légitimité de la couronne. Connaissant Henri VIII, dont la cruauté proverbiale a souillé à jamais le nom des Tudor, l'avocat se sait lui-même en grand danger.
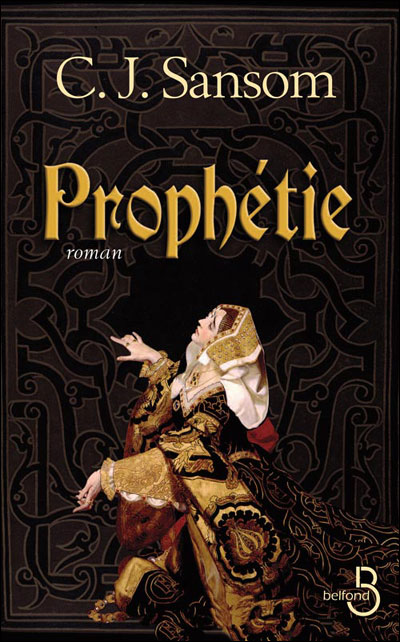 Quatrième de couverture :
Quatrième de couverture :
Angleterre, 1543. Après la Réforme, le retour de Henry VIII au catholicisme fait régner la terreur dans tout le pays. Censure, persécution, bûcher… Personne n'est à l'abri d'une condamnation pour hérésie.
Réhabilité depuis peu et chargé de défendre un jeune exalté interné à l'asile de Bedlam, l'humaniste Matthew Shardlake entend se tenir à l'écart des conflits. Jusqu'à ce que l'un de ses pairs soit retrouvé noyé dans la fontaine de Lincoln's Inn, la gorge tranchée.
Au nom de leur vieille amitié et par affection pour la veuve du défunt, Matthew se lance à la poursuite du coupable. Mais, quand plusieurs meurtres étrangement similaires sont commis coup sur coup, son enquête prend une tournure inquiétante.
Une piste s'impose peu à peu : celle d'un tueur inspiré par l'Apocalypse de saint Jean…
Avis personnel :
Il en va de la lecture de certains romans comme de la découverte d'une pépite d'or. Dès les premières lignes de Dissolution - qui n'est pas sans rappeler l'ambiance noire et oppressante de l'excellentissime film Le nom de la rose (je parle du film car je n'ai pas lu le livre d'Umberto Eco) - j'ai su qu'il en serait ainsi avec cet attachant personnage M. Shardlake. Depuis cette découverte, je m'évertue à remonter le filon !
Bref, la série est captivante par ses intrigues, dépaysante par son décor, profonde par l'épaisseur des "héros". Le tout écrit d'une main de maître, servi par un vocable raffiné et d'époque.
Un régal !


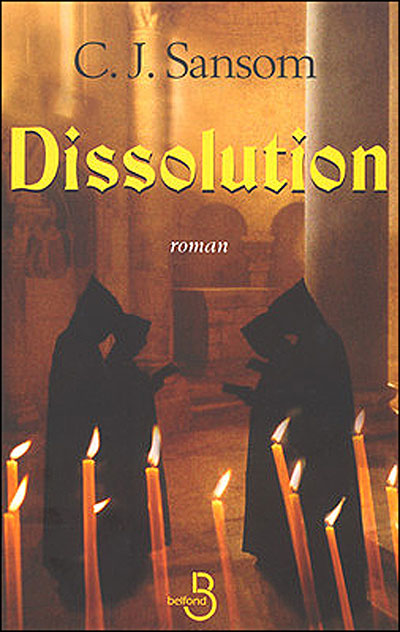
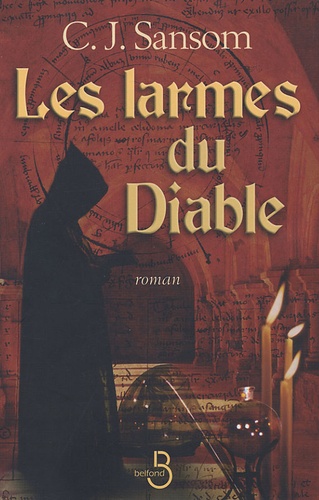
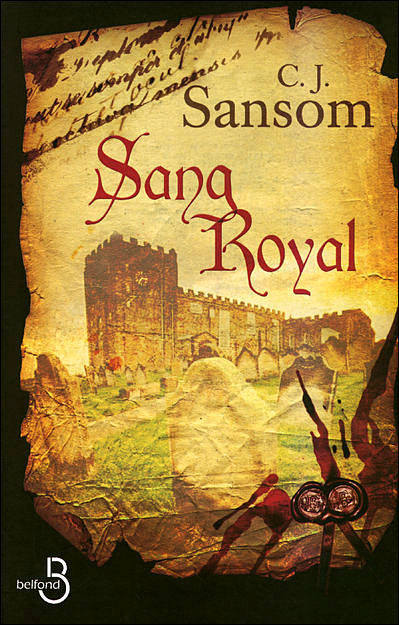
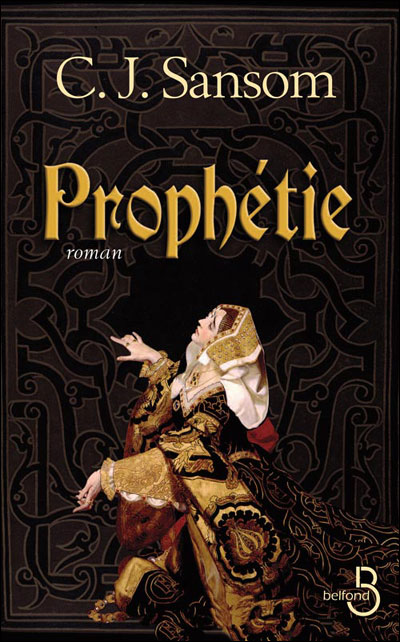




), la fin s'avère bâclée. Boycott !